Quelques cas pratiques de Protection Juridique
Vous recevez un avis à tiers détenteur par courrier recommandé

En cas d’impayés / de créances (impôts, amende, frais de cantine) à l’égard d’une administration (État, commune, hôpital…), le débiteur peut faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur (SATD).
Cette procédure permet donc à l’administration de se faire payer, en s’adressant à un tiers, des sommes détenues pour le débiteur ou devant lui être versée (la banque, le plus souvent, ou l’employeur).
La SATD peut concerner une ou plusieurs dettes du débiteur.
L’avis de saisie à tiers détenteur est simultanément adressé (souvent en lettre recommandée avec accusé de réception) au débiteur et au(x) tiers détendeur(s). On parle de notification : c’est une formalité consistant à porter à la connaissance d’une personne un acte de procédure ou une décision.
Cet avis doit respecter certaines formes et doit mentionner les voies de recours dont dispose le débiteur et les délais à respecter.
Dès réception de l’avis (souvent adressé en lettre recommandée), le tiers détenteur doit verser la somme impayée dans le délai imparti (30 jours).
A défaut de paiement, des mesures coercitives seront engagées
Que vous soyez tiers ou débiteur, si vous recevez un SATD, le Service de Protection Juridique pourra vous accompagner.
Accident du travail ou accident de trajet
Qu’est-ce qu’un accident du travail ?
Un accident de travail est un événement soudain et imprévisible qui, quelle qu’en soit la raison, a causé au salarié un dommage corporel ou psychologique. Il doit survenir pendant son activité professionnelle et sur son lieu de travail, lorsqu’il était sous l’autorité de l’employeur. Il doit être daté de manière certaine.
Le fait que l’origine soit soudaine permet de différencier l’accident du travail de la maladie professionnelle.
La qualification d’accident du travail peut être écartée si le fait accidentel est la conséquence de faits non professionnels.
La victime d’un accident lié au travail doit informer (ou faire informer) par tout moyen (mail, téléphone, SMS, …) son employeur de l’accident de travail. Cette démarche doit être faite dans la journée où s’est produit l’accident ou au plus tard dans les 24 heures.
L’employeur doit déclarer l’accident de travail dans les 48 heures soit à la CPAM soit à la MSA (CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie – MSA : Mutualité sociale agricole dans les 48 heures (dimanches et jours fériés non compris). Il lui est possible de faire des remarques argumentées sur le caractère professionnel ou non de l’accident.
Qu’est-ce qu’un accident de trajet ?
Un accident de trajet est un événement soudain et imprévu qui vous a causé un dommage corporel et qui s’est produit entre les points suivants :
- Votre résidence et votre lieu de travail.
Votre résidence peut être votre habitation principale, également être une maison secondaire habituelle sous certaines conditions, mais aussi tout autre lieu ou la personne se rend pour des raisons d’ordre familial ou d’agrément). Ce trajet entre votre domicile et votre lieu de travail doit être le plus direct possible.
- Votre lieu de travail et le lieu de restauration où vous vous rendez pendant la pause repas.
Le lieu de restauration désigne le restaurant, la cantine ou le lieu où sont pris habituellement les repas.
C’est à la victime de l’accident de démontrer que les conditions sont réunies pour que l’accident soit retenu comme un accident de trajet.
L’accident de trajet doit être déclaré dans les 24 heures à l’employeur par le salarié.
Confronté(e) à une de ces situations, contactez notre Service de Protection Juridique.

Heures d’astreinte dans la fonction publique hospitalière

Le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements hospitaliers définit les périodes d’astreintes comme des périodes pendant lesquelles l’agent doit pouvoir intervenir à tout moment, alors qu’il n’est pas sur son lieu de travail et qu’il n’est pas à la disposition immédiate de son employeur.
Le chef d’établissement établit, après avis du Comité Social et Économique, la liste des activités, services et catégories de personnel concernés ainsi que le mode d’organisation retenu.
Les astreintes sont organisées en faisant appel, en priorité, au personnel volontaire. L’accord du salarié est obligatoire.
Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation.
Dans la fonction publique hospitalière, le repos compensateur est égal au quart de la durée de l’astreinte.
Les heures sont indemnisées selon le calcul suivant :
- [¼ x (rémunération brute annuelle + indemnité de résidence annuelle)] /1820
Outre le respect des garanties précitées, l’organisation des astreintes doit respecter une double limite :
- Un agent ne peut pas être d’astreinte plus d’un samedi, un dimanche et un jour férié par mois.
- La durée de l’astreinte ne peut excéder 72h pour 15 jours (120h pour les services de prélèvement et transplantation).
En cas de dépassement du plafond réglementaire de 72h, pour 15 jours par agent, le système d’astreinte mis en place est illégal.
Ni les textes législatifs et réglementaires ni la jurisprudence ne permettent de déroger aux bornes maximales d’astreinte, y compris au nom du principe de continuité du service public.
J’ai un litige et je dois faire une réclamation ou diligenter une procédure. Comment procéder pour bénéficier des garanties « Protection Juridique » en tant que sociétaire AIAS ?
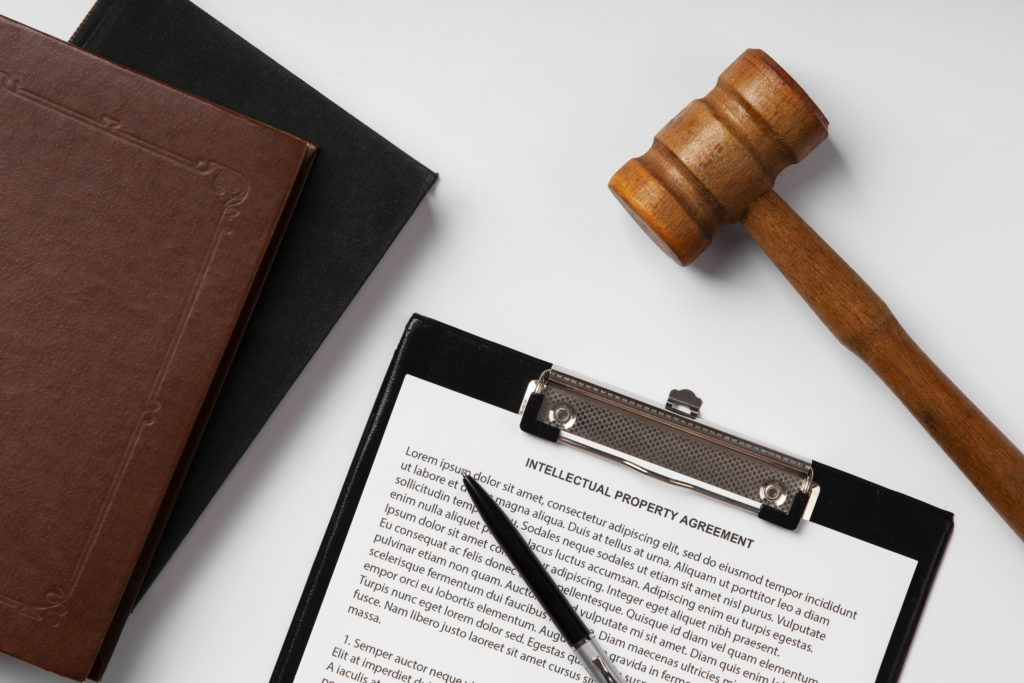
Avant toute démarche, il convient de contacter les services de l’AIAS.
Les actes de procédure et consultations antérieurs à la déclaration de sinistre ne seront pas pris en charge par notre partenaire-assureur.
Si votre demande est validée, vous pourrez contacter le service de Protection Juridique.
Selon les éléments du dossier et après analyse, celui-ci acceptera ou pas la prise en charge.
En cas de prise en charge, l’assureur pourra vous orienter vers un avocat de son réseau. L’adhérent AIAS conserve néanmoins le libre choix de son conseil. Il lui appartiendra alors de procéder au règlement des honoraires. Il sera ensuite remboursé sur présentation du justificatif de règlement des honoraires réclamés et de la facture détaillée mentionnant les diligences accomplies (stade de la procédure, temps passé, et copie d’un acte de procédure), à hauteur des plafonds indiqués dans la notice « PJ ».
NB : En application des Conditions Générales du contrat, l’adhérent de l’AIAS ne peut saisir directement un avocat, une personne qualifiée ou une juridiction, à peine de perdre son droit à garantie.
En effet, lorsque un adhérent entend exercer un recours à l’encontre d’un tiers (personne physique, personne morale ou administration), les services de Protection Juridique ne pourront intervenir que si – après analyse – celui-ci est estimé « fondé en droit ».
Toutefois, même en cas de refus de prise en charge initial (non fondement en droit du recours envisagé), en cas de gain de cause, le service de Protection Juridique pourra procéder à une nouvelle analyse.
Les modalités de prise en charge des frais et honoraires des avocats sont fixées par les dispositions des Conditions Générales du contrat.
Pour prise en charge, les faits générateurs du différend doivent avoir eu lieu après la souscription du contrat.
Professionnel du soin ou du social, libéral ou salarié, pour souscrire à titre individuel aux garanties Responsabilité Civile & Protection Juridique de l’AIAS, contactez-nous !